Description
Référence : 31997
Octave FESTY – L’AGRCULTURE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
L’UTILISATION DES JACHERES
1950, format : 145×230, 155 pages, sans illustration[s].broché, tranche de dos avec un petit manque, bon état intérieur, quelques traits de crayon dans la marge
Bibliothèque d’Histoire Economique et Sociale : Directeurs : G. Bourgin, E. Dolléans, E. Labrousse
L’AGRCULTURE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par Octave FESTY
-L’UTILISATION DES JACHERES – 1789-1795 – étude d’histoire économique
OUVRAGE PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
INTRODUCTION
• Dans un ouvrage précédent : L’Agriculture pendant la Révolution française. Les conditions de production et de récolte des céréales, nous avons rencontré la jachère, mais nous n’avons eu à la considérer qu’en tant qu’élément fondamental de l’assolement triennal ou biennal d’alors, en tant que nécessité imposée par un régime de culture où dominait souverainement la production des grains. Nous avons montré que, sous l’impulsion d’idées nouvelles, l’assolement traditionnel était quelque peu bousculé, qu’en essayant de le transformer par la création de prairies artificielles, on lui enlevait des terres qui, par cela même, n’avaient plus à subir la jachère au moins pour un temps; et nous avons étudié le conflit survenu, pour l’occupation d’une partie du sol, entre la production du blé, reposant sur la jachère, et la formation de prairies artificielles, qui portait atteinte à la jachère. Mais nous n’avons pas traité des prairies artificielles en elles-mêmes, de leurs conditions, de leurs difficultés propres; nous n’avons pas montré comment et dans quelles limites elles ont pu, tous comptes faits, restreindre la jachère.
• Cependant il existe des moyens d’utiliser les terres en jachère tout en respectant, à la différence de ce que font les prairies artificielles, leur assolement (triennal ou biennal) : au lieu de laisser improductive la jachère qui suit les deux premières années ou la première année (suivant le cas) de l’assolement, on la charge de produits autres que les céréales, produits dont la végétation peut s’intercaler entre la fin de la seconde année de l’assolement triennal et le début de la première année d’une nouvelle période d’assolement, lai méthode étant analogue dans le cas d’un assolement biennal. Les plantes qu’on peut ainsi faire produire par la terre destinée à rester en jachère sont nombreuses, trop nombreuses pour que nous nous intéressions à toutes; nous ne retiendrons que les deux grandes catégories des fourrages annuels et des légumes de toute sorte.
• •
TABLE DES MATIÈRES
• Introduction •
CHAPITRE PREMIER
• La jachère • Définition et objets. — Durée. — La jachère dans les anciennes provinces. — Utilisation de la jachère : distinction; évolution des idées; le programme de l’« agriculture nouvelle». — L’extension des surfaces à cultiver en blé et l’accroissement des jachères. — Facteurs d’extension : les défrichements, les déboisements, les défoncements de prairies; la pénurie de bras, d’animaux de trait, d’engrais. — Attaques contre la jachère; ajournement de leur suppression. — Besoin croissant de subsistances : augmentation de la population; exode rural; importation de produits agricoles; exigences nouvelles des consommateurs : viande, légumes, et nécessité d’y satisfaire. — L’alternance des cultures. — Les intempéries facteur du progrès agricole. — Cultures complémentaires ou de remplacement de la culture des grains. •
CHAPITRE II
• LEs PRAIRIES ARTIFICIELLES • Rareté et mauvaise qualité des prés naturels; leur défoncement fréquent; acidité des sols; inondations. — Les prairies artificielles sous l’Ancien régime; dans la généralité de Paris, en Picardie, dans le Roussillon, etc. — Causes de succès : besoin accru de fourrage par suite de l’augmentation des bestiaux, intelligence des avantages des prairies artificielles, propagande et vulgarisation des méthodes de culture; traités, mémoires, concours. — Le Code rural. — La réaction contre la liberté des cultures; l’affaire Marbeuf et l’arrêté du 13 germinal an II du Comité de Salut public; résultats en ce qui concerne les prairies artificielles. — Obstacles : ignorance, routine, interdiction de dessoler et exceptions, brièveté des baux, morcellement et partage des biens communaux, droit de parcours et de vaine pâture, dommages causés par les bestiaux, rareté, mauvaise qualité et prix excessif des semences, achats à l’extérieur et exportation. •
CHAPITRE III
• Fourrages annuels et légumes divers 57 • Catégories des fourrages annuels et des légumes. — La sécheresse de 1785 et l’arrêt du Conseil du 17 mai. — Le Comité d’administration de l’agriculture. — Parmentier : les racines potagères ou fourragères et la jachère. — La culture du turneps, de la betterave champêtre, du maïs. — Les légumes et fourrages annuels contre la jachère; concurrence avec les prairies artificielles; culture de la vesce. — Vulgarisation. — Difficultés d’obtenir des semences; action de la Commission des subsistances. — Situation de l’approvisionnement en semences au printemps de l’an II; moyens de l’améliorer. — L’avis aux cultivateurs du 13 ventôse an II. — Abondance des demandes de semences. — Action de la Commission du commerce et des approvisionnements. — Préparation pour les ensemencements du printemps de l’an III : abondance des demandes; difficultés d’y donner suite; tentatives d’achats de graines de semences à l’intérieur et à l’extérieur. — Mise, par l’Agence des subsistances de Paris, à la disposition de la Commission d’agriculture et des arts de légumes impropres à la consommation, à employer comme semences; intervention du Comité de sûreté générale, puis du Comité de Salut public. •
CHAPIRE IV.
• LA POMME DE TERRE. — 1 89 • Avant 1789 : principales provinces de culture; Mustel, Duhamel du Monceau; la disette de 1770; le concours de l’Académie de Besançon et Parmentier; la Société royale d’agriculture; Turgot et Arthur Young. — L’article de Parmentier dans le Cours complet d’agriculture, et son Traité sur la culture et les usages de la pomme de terre. — Extension de la consommation. — Concours et attribution de prix. — Enquête des commissaires-observateurs (1793) : régions de non-production et de production : accroissement de la culture par suite de la cherté du pain; effets de la sécheresse de 1798. — Arrêté et circulaire de la Commission des subsistances du nivôse an II. — La culture des pommes de terre par les journaliers sans terres. — Faveur croissante à la pomme de terre : hausse des prix, spéculation. — Projets de culture obligatoire. — Décret du 23 nivôse an II; applications illégales de ce décret; enthousiasme pour la production des pommes de terre. •
CHAPITRE V.
• LA POMME DE TERRE. — I12 • L’opinion au printemps de l’an II sur la culture de la pomme de terre; les détracteurs. — Instruction et circulaire du 24 pluviôse. — Surabondance des demandes de semences; premiers signes de pénurie. — Apogée des demandes (pluviôse-germinal an II); leur total; rareté de la semence. — Montant des demandes satisfaites. • _ La fin de l’an II. — Préparation des ensemencements de l’an III : instruction et circulaire du 21 nivôse. — Les intempéries et les semences de pommes de terre. — Insuffisance des quantités — Proclamation du Comité de Salut public du 8 floréal an 111 — Etat de la culture à la fin de l’an III : quelques réponses à l’enquête économique du 15 fructidor; augmentation de la culture; les facteurs défavorables; accroissement de la consommation; aliment pour l’homme ou pour le bétail, ou pour les deux catégories de consommateurs?— Confusion. — Distinction à pratiquer d’après les espèces de pommes de terre.
• Conclusion
• La jachère et l’agriculture nouvelle; nécessité de nouvelles et immédiates ressources alimentaires; propagande en faveur de la culture de légumes divers et de la pomme de terre; l’établissement des prairies artificielles attire moins l’attention. — Insuffisance de la quantité do semences disponibles : obstacle résultant des difficultés de transport; recherche de semences en France et à l’étranger. — Rareté de la culture en grand des légumes. — Progrès accomplis de 1789 à 179a : faibles dans l’extension des prairies artificielles; développement de la culture des légumes divers et surtout des pommes de terre; conséquences limitées sur l’étendue de la jachère.
• APPENDICE • Index des noms cités •
L’AGRCULTURE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par Octave FESTY
-L’UTILISATION DES JACHERES – 1789-1795 – étude d’histoire économique
OUVRAGE PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
INTRODUCTION
• Dans un ouvrage précédent : L’Agriculture pendant la Révolution française. Les conditions de production et de récolte des céréales, nous avons rencontré la jachère, mais nous n’avons eu à la considérer qu’en tant qu’élément fondamental de l’assolement triennal ou biennal d’alors, en tant que nécessité imposée par un régime de culture où dominait souverainement la production des grains. Nous avons montré que, sous l’impulsion d’idées nouvelles, l’assolement traditionnel était quelque peu bousculé, qu’en essayant de le transformer par la création de prairies artificielles, on lui enlevait des terres qui, par cela même, n’avaient plus à subir la jachère au moins pour un temps; et nous avons étudié le conflit survenu, pour l’occupation d’une partie du sol, entre la production du blé, reposant sur la jachère, et la formation de prairies artificielles, qui portait atteinte à la jachère. Mais nous n’avons pas traité des prairies artificielles en elles-mêmes, de leurs conditions, de leurs difficultés propres; nous n’avons pas montré comment et dans quelles limites elles ont pu, tous comptes faits, restreindre la jachère.
• Cependant il existe des moyens d’utiliser les terres en jachère tout en respectant, à la différence de ce que font les prairies artificielles, leur assolement (triennal ou biennal) : au lieu de laisser improductive la jachère qui suit les deux premières années ou la première année (suivant le cas) de l’assolement, on la charge de produits autres que les céréales, produits dont la végétation peut s’intercaler entre la fin de la seconde année de l’assolement triennal et le début de la première année d’une nouvelle période d’assolement, lai méthode étant analogue dans le cas d’un assolement biennal. Les plantes qu’on peut ainsi faire produire par la terre destinée à rester en jachère sont nombreuses, trop nombreuses pour que nous nous intéressions à toutes; nous ne retiendrons que les deux grandes catégories des fourrages annuels et des légumes de toute sorte.
• •
TABLE DES MATIÈRES
• Introduction •
CHAPITRE PREMIER
• La jachère • Définition et objets. — Durée. — La jachère dans les anciennes provinces. — Utilisation de la jachère : distinction; évolution des idées; le programme de l’« agriculture nouvelle». — L’extension des surfaces à cultiver en blé et l’accroissement des jachères. — Facteurs d’extension : les défrichements, les déboisements, les défoncements de prairies; la pénurie de bras, d’animaux de trait, d’engrais. — Attaques contre la jachère; ajournement de leur suppression. — Besoin croissant de subsistances : augmentation de la population; exode rural; importation de produits agricoles; exigences nouvelles des consommateurs : viande, légumes, et nécessité d’y satisfaire. — L’alternance des cultures. — Les intempéries facteur du progrès agricole. — Cultures complémentaires ou de remplacement de la culture des grains. •
CHAPITRE II
• LEs PRAIRIES ARTIFICIELLES • Rareté et mauvaise qualité des prés naturels; leur défoncement fréquent; acidité des sols; inondations. — Les prairies artificielles sous l’Ancien régime; dans la généralité de Paris, en Picardie, dans le Roussillon, etc. — Causes de succès : besoin accru de fourrage par suite de l’augmentation des bestiaux, intelligence des avantages des prairies artificielles, propagande et vulgarisation des méthodes de culture; traités, mémoires, concours. — Le Code rural. — La réaction contre la liberté des cultures; l’affaire Marbeuf et l’arrêté du 13 germinal an II du Comité de Salut public; résultats en ce qui concerne les prairies artificielles. — Obstacles : ignorance, routine, interdiction de dessoler et exceptions, brièveté des baux, morcellement et partage des biens communaux, droit de parcours et de vaine pâture, dommages causés par les bestiaux, rareté, mauvaise qualité et prix excessif des semences, achats à l’extérieur et exportation. •
CHAPITRE III
• Fourrages annuels et légumes divers 57 • Catégories des fourrages annuels et des légumes. — La sécheresse de 1785 et l’arrêt du Conseil du 17 mai. — Le Comité d’administration de l’agriculture. — Parmentier : les racines potagères ou fourragères et la jachère. — La culture du turneps, de la betterave champêtre, du maïs. — Les légumes et fourrages annuels contre la jachère; concurrence avec les prairies artificielles; culture de la vesce. — Vulgarisation. — Difficultés d’obtenir des semences; action de la Commission des subsistances. — Situation de l’approvisionnement en semences au printemps de l’an II; moyens de l’améliorer. — L’avis aux cultivateurs du 13 ventôse an II. — Abondance des demandes de semences. — Action de la Commission du commerce et des approvisionnements. — Préparation pour les ensemencements du printemps de l’an III : abondance des demandes; difficultés d’y donner suite; tentatives d’achats de graines de semences à l’intérieur et à l’extérieur. — Mise, par l’Agence des subsistances de Paris, à la disposition de la Commission d’agriculture et des arts de légumes impropres à la consommation, à employer comme semences; intervention du Comité de sûreté générale, puis du Comité de Salut public. •
CHAPIRE IV.
• LA POMME DE TERRE. — 1 89 • Avant 1789 : principales provinces de culture; Mustel, Duhamel du Monceau; la disette de 1770; le concours de l’Académie de Besançon et Parmentier; la Société royale d’agriculture; Turgot et Arthur Young. — L’article de Parmentier dans le Cours complet d’agriculture, et son Traité sur la culture et les usages de la pomme de terre. — Extension de la consommation. — Concours et attribution de prix. — Enquête des commissaires-observateurs (1793) : régions de non-production et de production : accroissement de la culture par suite de la cherté du pain; effets de la sécheresse de 1798. — Arrêté et circulaire de la Commission des subsistances du nivôse an II. — La culture des pommes de terre par les journaliers sans terres. — Faveur croissante à la pomme de terre : hausse des prix, spéculation. — Projets de culture obligatoire. — Décret du 23 nivôse an II; applications illégales de ce décret; enthousiasme pour la production des pommes de terre. •
CHAPITRE V.
• LA POMME DE TERRE. — I12 • L’opinion au printemps de l’an II sur la culture de la pomme de terre; les détracteurs. — Instruction et circulaire du 24 pluviôse. — Surabondance des demandes de semences; premiers signes de pénurie. — Apogée des demandes (pluviôse-germinal an II); leur total; rareté de la semence. — Montant des demandes satisfaites. • _ La fin de l’an II. — Préparation des ensemencements de l’an III : instruction et circulaire du 21 nivôse. — Les intempéries et les semences de pommes de terre. — Insuffisance des quantités — Proclamation du Comité de Salut public du 8 floréal an 111 — Etat de la culture à la fin de l’an III : quelques réponses à l’enquête économique du 15 fructidor; augmentation de la culture; les facteurs défavorables; accroissement de la consommation; aliment pour l’homme ou pour le bétail, ou pour les deux catégories de consommateurs?— Confusion. — Distinction à pratiquer d’après les espèces de pommes de terre.
• Conclusion
• La jachère et l’agriculture nouvelle; nécessité de nouvelles et immédiates ressources alimentaires; propagande en faveur de la culture de légumes divers et de la pomme de terre; l’établissement des prairies artificielles attire moins l’attention. — Insuffisance de la quantité do semences disponibles : obstacle résultant des difficultés de transport; recherche de semences en France et à l’étranger. — Rareté de la culture en grand des légumes. — Progrès accomplis de 1789 à 179a : faibles dans l’extension des prairies artificielles; développement de la culture des légumes divers et surtout des pommes de terre; conséquences limitées sur l’étendue de la jachère.
• APPENDICE • Index des noms cités •

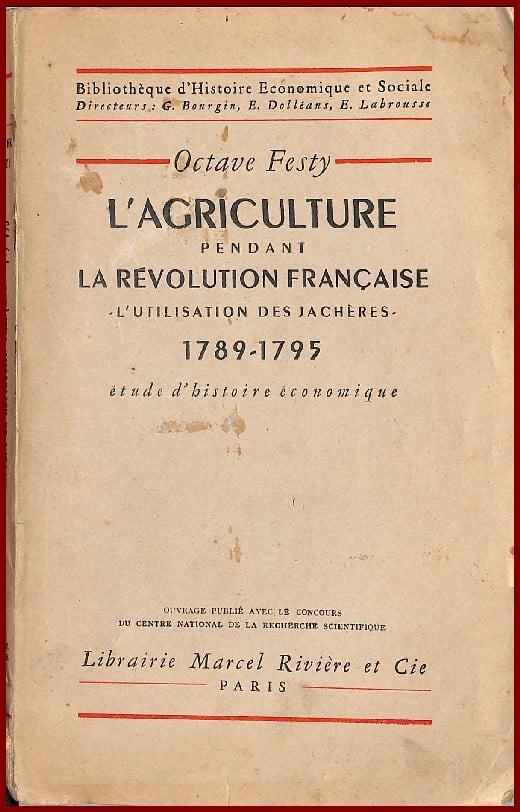
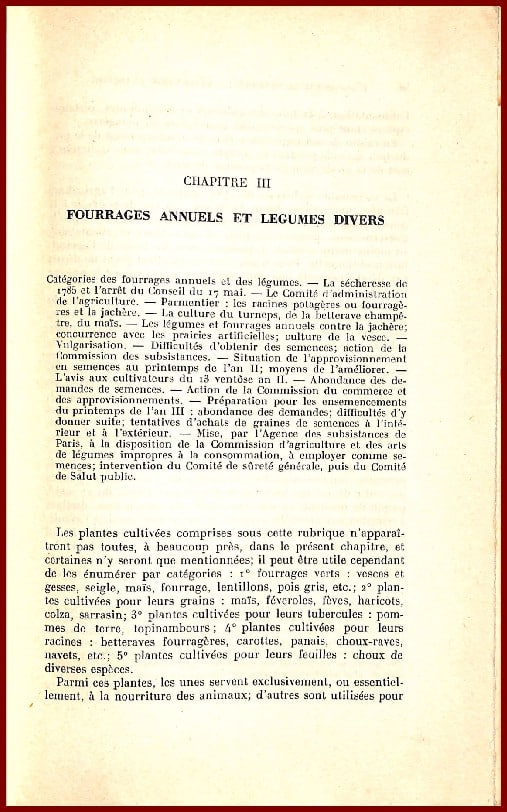

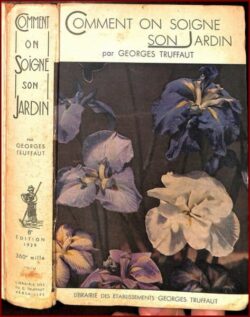
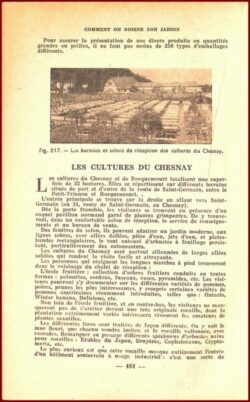
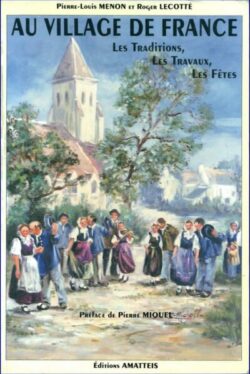

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.