Description
Référence : 30446
EDELSTEIN Melvin Allen – La feuille villageoise
Communication et modernisation dans les régions rurales pendant la Révolution
1977, format : 155×240, 351 pages, sans ill. broché
La feuille villageoise, Commission d’Histoire économique et sociale de la Révomution française
INTRODUCTION
L’histoire de la presse suscite en France un intérêt renouvelé. Vers 1960 déjà, certains journaux révolutionnaires célèbres, tels Le Patriote français de Brissot et Les Révolutions de Paris de Prudhomme firent l’objet d’études spéciales. Mais en 1962, J. Godechot constatait que « malgré le travail qui paraît avoir été réalisé, il reste encore énormément à faire ».
Bien qu’en 1860, Eugène Hatin ait déclaré que La Feuille villageoise faisait partie des journaux révolutionnaires les plus originaux et les plus diffusés, elle était quand même restée dans l’obscurité. En 1888, A. Aulard réclamait qu’une étude lui soit consacrée ; cependant, il fallut attendre jusqu’en 1963 pour voir Mlle Françoise Sabatier présenter un mémoire de D.E.S. devant la Faculté des Lettres de Montpellier, encore n’utilisait-elle qu’une année de ce journal.
Commencé en 1962, en tant que thèse de doctorat, mon propre travail, plus détaillé, part d’un point de vue différent.
L’intérêt de La Feuille villageoise réside dans le fait qu’elle fut le premier journal à caractère politique publié pour les paysans et qui ait connu un certain succès, fait sur lequel les historiens n’ont pas insisté. En dépit de cet aspect, elle n’a jamais été exploitée comme une expression de l’attitude des révolutionnaires à l’égard de la paysannerie. Si Georges Lefebvre s’étonna que le compte rendu du Moniteur sur la loi du 14 août 1792 aliénant les biens des émigrés, la présentait comme la mesure la plus favorable qu’on ait jamais proposé aux paysans, ce fut l’une des seules fois où il se servit des journaux en matière de politique agraire, et il ne mentionna jamais La Feuille villageoise. De plus, aucun ouvrage ne traite de la manière dont la presse révolutionnaire exprima ses vues sur les lois agraires. Marc Bloch ne se réfère qu’une fois à La Feuille villageoise dans une note. Seul Octave Festy se sert des journaux dans un article sur les techniques agricoles. Nous sommes donc seul à avoir utilisé La Feuille villageoise pour l’étude des problèmes ruraux. Enfin, Marcel Reinhard y a recouru par la suite, pour attirer l’attention des historiens sur la déchristianisation.
Notre étude analyse et apprécie la portée du journal en tant qu’instrument de propagande. Dans ce domaine, Georges Lefebvre a fait oeuvre de pionnier. Il insiste sur le fait qu’en 1789 et longtemps après, les nouvelles se répandaient à la campagne de bouche à oreille. La conversation était le mode de diffusion par excellence. C’était au travail, à l’église, au marché, que les paysans prenaient conscience des idées et des événements récents. Le même auteur insista aussi sur le rôle des colporteurs et chanteurs ambulants. L’analphabétisme, la lenteur des communications pesaient lourdement sur la propagande de masse par les pamphlets, journaux et réunions publiques. Si la presse contribua faiblement à déclencher l’agitation rurale en 1789, la Révolution agit comme un stimulant sur le développement de la presse et son action en tant que moyen de propagande. « En 1789, l’imprimé a joué un rôle important dans les rangs de la bourgeoisie citadine et rurale, mais il n’a pas atteint directement les masses populaires… mais la Révolution une fois commencée, cette propagande s’est développée puissamment… », et G. Lefebvre ajoute : « C’est à l’étude de.ces différents facteurs que les historiens pourraient particulièrement se consacrer avec fruit ». Toutefois, jusqu’alors, peu d’études s’attachent à pénétrer la formation de la mentalité révolutionnaire et la communication des idées dans les campagnes.
Comme G. Lefebvre, George Rudé soutient que la communication orale fut prépondérante dans la propagation des idées et la formation de l’opinion. Il insiste sur le rôle des discours politiques, dans les clubs, les assemblées de section, la garde nationale, les boutiques et le marché.
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE
ORIGINES ET ÉVOLUTION DE La Feuille villageoise
Chapitre Premier. — Les objectifs du journal
Tableau I Fréquence de création des journaux pour la campagne
Chapitre II. — Les rubriques du journal
Tableau II. Nouvelles de l’intérieur et de l’étranger
Tableau III. Fréquence des articles sur la Géographie universelle
Tableau IV. Fréquence des articles sur 1’Economie rurale
Chapitre III. — L’évolution des rubriques
Chapitre IV. — Le journal et la vie politique
Chapitre V. — Le journal, moyen de communication
Chapitre VI. — Les abonnés. Analyse régionale et socioprofessionnelle
Schéma. Circulation de La Feuille villageoise (1790-1795)
Tableau V. Nombre de lettres et de questions
Tableau VI. Nombre de sujets mentionnés
Tableau VII. Origines socio-professionnelles des correspondants
Tableau VIII. Sujets traités dans les lettres écrites par le clergé
Tableau IX. Sujets traités dans les lettres écrites par des administrateurs
DEUXIÈME PARTIE
MODERNISATION ET PARTICIPATION POLITIQUE
Chapitre Premier. — Eclaircissements sur la Constitution
Chapitre II. — Démocratie de participation ou gouvernement efficace
a) Publicité des séances des administrations locales
b) Le rôle des municipalités rurales
c) Le droit de vote et l’éligibilité
d) Le choix des administrateurs
e) Le nombre des élus ruraux
Chapitre III. — Républicains enthousiastes, mais démocrates douteux
TROISIÈME PARTIE
RÉFORME DES IMPÔTS ET PRIX DE LA LIBERTÉ
Chapitre Premier. — Nécessité des impôts
Chapitre II. — Eclaircissements sur les nouveaux impôts
Chapitre III. — Accélération de la collecte. Laxisme de l’administration ou égoïsme des contribuables?
Chapitre IV. — La liberté coûte-t-elle moins cher que la tyrannie ?
QUATRIÈME PARTIE
L’ASSIGNAT. STIMULATION D’UNE ÉCONOMIE STAGNANTE
Chapitre Premier. — Défense de l’assignat, stimulateur économique
Chapitre II. — Entretien de la confiance dans l’assignat
Chapitre III. — Petits assignats et billets de confiance
Chapitre IV. — Liberté du commerce de l’argent. Politiques monétaires antagonistes
CINQUIÈME PARTIE
LA RÉFORME AGRAIRE
Chapitre Premier. — Abolition du régime seigneurial. Emancipation ou asservissement ?
Chapitre II. — Propriétaires, fermiers et métayers. A qui le profit devrait-il revenir ?
Chapitre III. — Cession de la terre. Mesure sociale ou mesure financière
Chapitre IV. — Libre choix des cultures et partage des biens communaux. Propriété privée ou propriété collective
SIXIÈME PARTIE
LE PROBLÈME DE LA SUBSISTANCE
Chapitre Premier. — Libéralisme ou dirigisme économique : l’élite urbaine contre les classes populaires
Chapitre II. — Révolution pro-capitaliste et pré-industrielle
Chapitre III. — Défense du « Maximum ». Les fermiers et marchands démasqués
Chapitre IV. — La fin de l’ e innocence » rurale
Chapitre V. — Le Socrate rustique. Le paysan modèle
Chapitre VI. — La Révolution française et le capitalisme
CONCLUSION
a) « Adieux aux bons villageois »
b) La Feuille villageoise et son action de propagande
APPENDICES
a) Création des journaux destinés aux campagnards
b) Quelques prix d’abonnement en 1792
c) Répartition des lettres par départements
INTRODUCTION
L’histoire de la presse suscite en France un intérêt renouvelé. Vers 1960 déjà, certains journaux révolutionnaires célèbres, tels Le Patriote français de Brissot et Les Révolutions de Paris de Prudhomme firent l’objet d’études spéciales. Mais en 1962, J. Godechot constatait que « malgré le travail qui paraît avoir été réalisé, il reste encore énormément à faire ».
Bien qu’en 1860, Eugène Hatin ait déclaré que La Feuille villageoise faisait partie des journaux révolutionnaires les plus originaux et les plus diffusés, elle était quand même restée dans l’obscurité. En 1888, A. Aulard réclamait qu’une étude lui soit consacrée ; cependant, il fallut attendre jusqu’en 1963 pour voir Mlle Françoise Sabatier présenter un mémoire de D.E.S. devant la Faculté des Lettres de Montpellier, encore n’utilisait-elle qu’une année de ce journal.
Commencé en 1962, en tant que thèse de doctorat, mon propre travail, plus détaillé, part d’un point de vue différent.
L’intérêt de La Feuille villageoise réside dans le fait qu’elle fut le premier journal à caractère politique publié pour les paysans et qui ait connu un certain succès, fait sur lequel les historiens n’ont pas insisté. En dépit de cet aspect, elle n’a jamais été exploitée comme une expression de l’attitude des révolutionnaires à l’égard de la paysannerie. Si Georges Lefebvre s’étonna que le compte rendu du Moniteur sur la loi du 14 août 1792 aliénant les biens des émigrés, la présentait comme la mesure la plus favorable qu’on ait jamais proposé aux paysans, ce fut l’une des seules fois où il se servit des journaux en matière de politique agraire, et il ne mentionna jamais La Feuille villageoise. De plus, aucun ouvrage ne traite de la manière dont la presse révolutionnaire exprima ses vues sur les lois agraires. Marc Bloch ne se réfère qu’une fois à La Feuille villageoise dans une note. Seul Octave Festy se sert des journaux dans un article sur les techniques agricoles. Nous sommes donc seul à avoir utilisé La Feuille villageoise pour l’étude des problèmes ruraux. Enfin, Marcel Reinhard y a recouru par la suite, pour attirer l’attention des historiens sur la déchristianisation.
Notre étude analyse et apprécie la portée du journal en tant qu’instrument de propagande. Dans ce domaine, Georges Lefebvre a fait oeuvre de pionnier. Il insiste sur le fait qu’en 1789 et longtemps après, les nouvelles se répandaient à la campagne de bouche à oreille. La conversation était le mode de diffusion par excellence. C’était au travail, à l’église, au marché, que les paysans prenaient conscience des idées et des événements récents. Le même auteur insista aussi sur le rôle des colporteurs et chanteurs ambulants. L’analphabétisme, la lenteur des communications pesaient lourdement sur la propagande de masse par les pamphlets, journaux et réunions publiques. Si la presse contribua faiblement à déclencher l’agitation rurale en 1789, la Révolution agit comme un stimulant sur le développement de la presse et son action en tant que moyen de propagande. « En 1789, l’imprimé a joué un rôle important dans les rangs de la bourgeoisie citadine et rurale, mais il n’a pas atteint directement les masses populaires… mais la Révolution une fois commencée, cette propagande s’est développée puissamment… », et G. Lefebvre ajoute : « C’est à l’étude de.ces différents facteurs que les historiens pourraient particulièrement se consacrer avec fruit ». Toutefois, jusqu’alors, peu d’études s’attachent à pénétrer la formation de la mentalité révolutionnaire et la communication des idées dans les campagnes.
Comme G. Lefebvre, George Rudé soutient que la communication orale fut prépondérante dans la propagation des idées et la formation de l’opinion. Il insiste sur le rôle des discours politiques, dans les clubs, les assemblées de section, la garde nationale, les boutiques et le marché.
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE
ORIGINES ET ÉVOLUTION DE La Feuille villageoise
Chapitre Premier. — Les objectifs du journal
Tableau I Fréquence de création des journaux pour la campagne
Chapitre II. — Les rubriques du journal
Tableau II. Nouvelles de l’intérieur et de l’étranger
Tableau III. Fréquence des articles sur la Géographie universelle
Tableau IV. Fréquence des articles sur 1’Economie rurale
Chapitre III. — L’évolution des rubriques
Chapitre IV. — Le journal et la vie politique
Chapitre V. — Le journal, moyen de communication
Chapitre VI. — Les abonnés. Analyse régionale et socioprofessionnelle
Schéma. Circulation de La Feuille villageoise (1790-1795)
Tableau V. Nombre de lettres et de questions
Tableau VI. Nombre de sujets mentionnés
Tableau VII. Origines socio-professionnelles des correspondants
Tableau VIII. Sujets traités dans les lettres écrites par le clergé
Tableau IX. Sujets traités dans les lettres écrites par des administrateurs
DEUXIÈME PARTIE
MODERNISATION ET PARTICIPATION POLITIQUE
Chapitre Premier. — Eclaircissements sur la Constitution
Chapitre II. — Démocratie de participation ou gouvernement efficace
a) Publicité des séances des administrations locales
b) Le rôle des municipalités rurales
c) Le droit de vote et l’éligibilité
d) Le choix des administrateurs
e) Le nombre des élus ruraux
Chapitre III. — Républicains enthousiastes, mais démocrates douteux
TROISIÈME PARTIE
RÉFORME DES IMPÔTS ET PRIX DE LA LIBERTÉ
Chapitre Premier. — Nécessité des impôts
Chapitre II. — Eclaircissements sur les nouveaux impôts
Chapitre III. — Accélération de la collecte. Laxisme de l’administration ou égoïsme des contribuables?
Chapitre IV. — La liberté coûte-t-elle moins cher que la tyrannie ?
QUATRIÈME PARTIE
L’ASSIGNAT. STIMULATION D’UNE ÉCONOMIE STAGNANTE
Chapitre Premier. — Défense de l’assignat, stimulateur économique
Chapitre II. — Entretien de la confiance dans l’assignat
Chapitre III. — Petits assignats et billets de confiance
Chapitre IV. — Liberté du commerce de l’argent. Politiques monétaires antagonistes
CINQUIÈME PARTIE
LA RÉFORME AGRAIRE
Chapitre Premier. — Abolition du régime seigneurial. Emancipation ou asservissement ?
Chapitre II. — Propriétaires, fermiers et métayers. A qui le profit devrait-il revenir ?
Chapitre III. — Cession de la terre. Mesure sociale ou mesure financière
Chapitre IV. — Libre choix des cultures et partage des biens communaux. Propriété privée ou propriété collective
SIXIÈME PARTIE
LE PROBLÈME DE LA SUBSISTANCE
Chapitre Premier. — Libéralisme ou dirigisme économique : l’élite urbaine contre les classes populaires
Chapitre II. — Révolution pro-capitaliste et pré-industrielle
Chapitre III. — Défense du « Maximum ». Les fermiers et marchands démasqués
Chapitre IV. — La fin de l’ e innocence » rurale
Chapitre V. — Le Socrate rustique. Le paysan modèle
Chapitre VI. — La Révolution française et le capitalisme
CONCLUSION
a) « Adieux aux bons villageois »
b) La Feuille villageoise et son action de propagande
APPENDICES
a) Création des journaux destinés aux campagnards
b) Quelques prix d’abonnement en 1792
c) Répartition des lettres par départements


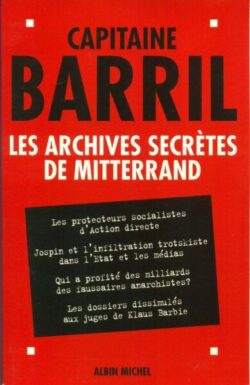
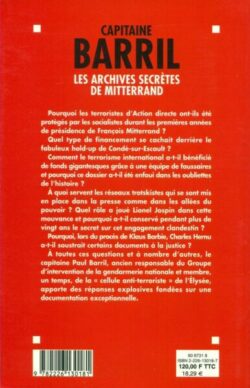

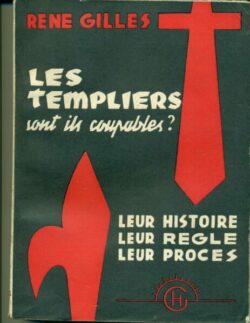
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.