Description
Référence : 30448
RAYER A. – Etude sur l’Economie Rurale de Seine-et-Marne
Rapport fait au nom de la Section d’économie de statistique et de législation agricole par M. JOUSSEAU
1883, format : 120×185, 306 pages, sans ill. broché
Etude sur l’Economie Rurale de Seine-et-Marne, TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE I. – Aspect du pays. — Composition du sol. — Climat
– II. — Le bétail
– III. — Animaux de trait
– IV. — Animaux de rente
– V. — Assolements
– VI. — Céréales
– VII. — Prairies naturelles et artificielles
– VIII. — Plantes sarclées et industrielles
– IX. — Vignes. — Vergers. — Bois
– X. — Produit brut et profits
– XI. — Voies de communication. — Débouchés
— Population . — Vie rurale. — Influence de Paris
— Rente. — Valeur foncière. — Salaires
XIII. — Capital d’exploitation. — Crédit agricole
– XIV. — Améliorations foncières. — Engrais
– XV. — De la propriété
– XVI. — De la culture
CHAPITRE XVII. – La chasse
— XVIII. — Assurances
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE I. – Arrondissement de Fontainebleau
– II. — Arrondissement de Provins
– III. — Arrondissement de Melun
– IV. — Arrondissement de Coulommiers
– V. — Arrondissement de Meaux
CONCLUSION
Extrait du CHAPITRE III – Arrondissement de Melun.
Nous trouvons dans cet arrondissement la culture la plus perfectionnée du département de Seine-et-Marne. Au delà de la Marne, dans le Multien, nous verrons un sol certainement meilleur, quant à la composition physique, mais nulle part nous ne rencontrerons des fermes mieux tenues que dans cette belle plaine comprise entre Mormant et Lieusaint. Ces deux régions possèdent à peu près les mêmes avantages sous le rapport des voies de communications et des débouchés. Paris est à peu près à égale distance de Melun et de Meaux, mais la culture industrielle, qui a commencé par le colza, le lin et se continue par la betterave, a fait depuis cinquante ans la supériorité du premier sur le second. Dès 1860, on comptait vingt-huit distilleries aux environs de Melun. Cette industrie, qui a presque doublé le produit brut, a été le début d’un progrès considérable. On a tout mis en oeuvre pour produire de la betterave, les terres ont été assainies par le drainage, enrichies par des apports considérables d’engrais chimiques. C’est ici qu’on fit usage pour la première fois des guanos du Pérou. La Seine-et-Marne, nous avons déjà eu l’occasion de le dire, en consommait autant que tout le reste de la France. Depuis longtemps déjà les engrais chimiques ont remplacé les guanos du Pérou dont les gisements sont épuisés. Cette riche culture en emploie pour 80 francs par hectare en plus des fumures qui sont entièrement réservées aux plantes sarclées.
La grande propriété occupe presque tout le territoire et parmi ces fermes importantes, disséminées sur un plateau composé d’un diluvium argilo-siliceux reposant sur un sous-sol d’argile rouge à meulière, il n’est pas rare d’en rencontrer qui ont une étendue de 300 hectares. Ces gros fermiers ont un capital d’exploitation de 800 francs par hectare, payent 40,000 francs de loyer, impôts compris, achètent pour 23,000 francs d’engrais et font 150,000 francs de produit brut. Le capital d’exploitation est le quart du capital foncier et le taux de la rente ne dépasse pas 3 1/2 p. 100. Tout est tenu avec ordre dans l’intérieur de la ferme, et la plus grande propreté règne dans les cultures. Les habitations de maître sont de véritables maisons bourgeoises entourées de fleurs et de verdure, avec tout le confortable désirable. Des critiques aux allures sévères proscriraient volontiers le bon goût des bâtiments ruraux. Tel n’est pas notre avis : li ne saurait trop, au contraire, embellir ces habitations pour en accroître l’attrait, sans tomber dans un luxe exagéré qui deviendrait onéreux et augmenterait inutilement les frais généraux. Ces lourds emplois demandent une surveillance continuelle : le fermier s’adjoint un chef de culture qui surveille le personnel et transmet les ordres ; une gouvernante préside aux travaux du ménage, soigne la basse-cour sous la direction de la maîtresse. L’industrie laitière disparaît devant l’engraissement du bétail. La fermière a une vie plus bourgeoise, plus agréable, et par cela même son rôle est moins actif dans la production. C’est une conséquence de la grande culture et des gros capitaux d’où découlent la richesse et la prospérité. Le petit village de Pouilly-le-Fort, situé près de Melun, restera désormais célèbre dans les annales agricoles de la Brie. C’est là, dans un petit enclos, que M. Pasteur fit publiquement, au mois de mai 1881, l’éclatante démonstration de sa découverte relative à la vaccination préventive des maladies charbonneuses, devant une nombreuse assistance de croyants et d’incrédules. Ces expériences, longuement discutées dans le monde scientifique, furent concluantes et à dater de cette époque la méthode Pasteur se répandit dans les campagnes y accomplissant de véritables prodiges.
Tout le sol n’est pas également bon aux environs de Melun, le canton sud est médiocre, c’est encore le Gâtinais sec et sablonneux qui remonte jusqu’aux bords de la Seine. Dans les communes de Cély, de Perthes, de Fleury-en-Bière, la rente tombe à 35 francs, trois fois moins que dans la plaine de Lieusaint. Entre Melun et Corbeil, toute la rive droite du fleuve est mauvaise, les bois, et les bruyères peuplées de lapins se partagent le sol. Mais cette vallée renferme de magnifiques paysages fort goûtés des Parisiens en quête de villégiature. Seine-Port est un joli petit pays bâti au milieu d’un site admirable. On y remarque l’ancienne résidence du duc d’Orléans, le château de Sainte-Assise, et les débris d’un pavillon bâti par Bouret, ancien fermier général, renommé par son luxe.
La vallée de la Seine et les environs de Melun sont peuplés de nombreux châteaux dont le plus remarquable est celui de Vaux-Praslin, ancienne et fastueuse demeure du surintendant Fouquet. Cette magnifique propriété un instant délaissée a été restaurée dans ces derniers temps par le propriétaire actuel, M. Sommier, grand raffineur parisien. Les naïades y ont fait leur réapparition, mais on n’entend plus la muse plaintive du bon La Fontaine pleurant sur le sort du malheureux Oronte.
La petite commune de La Rochette évoque le souvenir d’une vieille et illustre famille agricole de la Brie. « Un nom, dit l’abbé Denis, qui a droit d’être signalé à tous égards, est celui de Moreau de La Rochette, inspecteur général des pépinières de France. Il était directeur des fermes du roi à Melun quand il fit l’acquisition, en 1751, de la terre de La Rochette, ainsi nommée à cause de son sol ingrat, rocailleux. Il s’attacha d’abord à mettre en bon état le peu de terre qui était cultivée, puis, grâce à son intelligence et à la constance de sa volonté, il étendit sa culture en dirigeant habilement les labours, et, en distribuant à piopos les engrais, il obtint ainsi de bonnes récoltes. Les succès se multipliant, il conçut le projet d’une école d’agriculture sur sa propriété. Il tourna ses vues principalement du côté des pépinières et employa à ce dessein des enfants trouvés des hôpitaux de Paris. Le terrain fut défoncé, une partie fut mise en culture et l’autre en bois. En treize années, quatre cents élèves sortis des hôpitaux avaient été formés au travail de la terre et étaient devenus jardiniers pépiniéristes, et lorsqu’en 1780 la terre de La Rochette, par suite des réformes de Necker, cessa d’être au compte du gouvernement il y existait 7,431,000 plants d’arbres de toute espèce. Moreau mourut à La Rochette en 1791. »
Les descendants de cette illustre famille s’occupèrent d’agriculture, d’élevage, de sport, et le dernier rejeton, récemment décédé, fut longtemps président de la Société d’agriculture de Melun.
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE I. – Aspect du pays. — Composition du sol. — Climat
– II. — Le bétail
– III. — Animaux de trait
– IV. — Animaux de rente
– V. — Assolements
– VI. — Céréales
– VII. — Prairies naturelles et artificielles
– VIII. — Plantes sarclées et industrielles
– IX. — Vignes. — Vergers. — Bois
– X. — Produit brut et profits
– XI. — Voies de communication. — Débouchés
— Population . — Vie rurale. — Influence de Paris
— Rente. — Valeur foncière. — Salaires
XIII. — Capital d’exploitation. — Crédit agricole
– XIV. — Améliorations foncières. — Engrais
– XV. — De la propriété
– XVI. — De la culture
CHAPITRE XVII. – La chasse
— XVIII. — Assurances
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE I. – Arrondissement de Fontainebleau
– II. — Arrondissement de Provins
– III. — Arrondissement de Melun
– IV. — Arrondissement de Coulommiers
– V. — Arrondissement de Meaux
CONCLUSION
Extrait du CHAPITRE III – Arrondissement de Melun.
Nous trouvons dans cet arrondissement la culture la plus perfectionnée du département de Seine-et-Marne. Au delà de la Marne, dans le Multien, nous verrons un sol certainement meilleur, quant à la composition physique, mais nulle part nous ne rencontrerons des fermes mieux tenues que dans cette belle plaine comprise entre Mormant et Lieusaint. Ces deux régions possèdent à peu près les mêmes avantages sous le rapport des voies de communications et des débouchés. Paris est à peu près à égale distance de Melun et de Meaux, mais la culture industrielle, qui a commencé par le colza, le lin et se continue par la betterave, a fait depuis cinquante ans la supériorité du premier sur le second. Dès 1860, on comptait vingt-huit distilleries aux environs de Melun. Cette industrie, qui a presque doublé le produit brut, a été le début d’un progrès considérable. On a tout mis en oeuvre pour produire de la betterave, les terres ont été assainies par le drainage, enrichies par des apports considérables d’engrais chimiques. C’est ici qu’on fit usage pour la première fois des guanos du Pérou. La Seine-et-Marne, nous avons déjà eu l’occasion de le dire, en consommait autant que tout le reste de la France. Depuis longtemps déjà les engrais chimiques ont remplacé les guanos du Pérou dont les gisements sont épuisés. Cette riche culture en emploie pour 80 francs par hectare en plus des fumures qui sont entièrement réservées aux plantes sarclées.
La grande propriété occupe presque tout le territoire et parmi ces fermes importantes, disséminées sur un plateau composé d’un diluvium argilo-siliceux reposant sur un sous-sol d’argile rouge à meulière, il n’est pas rare d’en rencontrer qui ont une étendue de 300 hectares. Ces gros fermiers ont un capital d’exploitation de 800 francs par hectare, payent 40,000 francs de loyer, impôts compris, achètent pour 23,000 francs d’engrais et font 150,000 francs de produit brut. Le capital d’exploitation est le quart du capital foncier et le taux de la rente ne dépasse pas 3 1/2 p. 100. Tout est tenu avec ordre dans l’intérieur de la ferme, et la plus grande propreté règne dans les cultures. Les habitations de maître sont de véritables maisons bourgeoises entourées de fleurs et de verdure, avec tout le confortable désirable. Des critiques aux allures sévères proscriraient volontiers le bon goût des bâtiments ruraux. Tel n’est pas notre avis : li ne saurait trop, au contraire, embellir ces habitations pour en accroître l’attrait, sans tomber dans un luxe exagéré qui deviendrait onéreux et augmenterait inutilement les frais généraux. Ces lourds emplois demandent une surveillance continuelle : le fermier s’adjoint un chef de culture qui surveille le personnel et transmet les ordres ; une gouvernante préside aux travaux du ménage, soigne la basse-cour sous la direction de la maîtresse. L’industrie laitière disparaît devant l’engraissement du bétail. La fermière a une vie plus bourgeoise, plus agréable, et par cela même son rôle est moins actif dans la production. C’est une conséquence de la grande culture et des gros capitaux d’où découlent la richesse et la prospérité. Le petit village de Pouilly-le-Fort, situé près de Melun, restera désormais célèbre dans les annales agricoles de la Brie. C’est là, dans un petit enclos, que M. Pasteur fit publiquement, au mois de mai 1881, l’éclatante démonstration de sa découverte relative à la vaccination préventive des maladies charbonneuses, devant une nombreuse assistance de croyants et d’incrédules. Ces expériences, longuement discutées dans le monde scientifique, furent concluantes et à dater de cette époque la méthode Pasteur se répandit dans les campagnes y accomplissant de véritables prodiges.
Tout le sol n’est pas également bon aux environs de Melun, le canton sud est médiocre, c’est encore le Gâtinais sec et sablonneux qui remonte jusqu’aux bords de la Seine. Dans les communes de Cély, de Perthes, de Fleury-en-Bière, la rente tombe à 35 francs, trois fois moins que dans la plaine de Lieusaint. Entre Melun et Corbeil, toute la rive droite du fleuve est mauvaise, les bois, et les bruyères peuplées de lapins se partagent le sol. Mais cette vallée renferme de magnifiques paysages fort goûtés des Parisiens en quête de villégiature. Seine-Port est un joli petit pays bâti au milieu d’un site admirable. On y remarque l’ancienne résidence du duc d’Orléans, le château de Sainte-Assise, et les débris d’un pavillon bâti par Bouret, ancien fermier général, renommé par son luxe.
La vallée de la Seine et les environs de Melun sont peuplés de nombreux châteaux dont le plus remarquable est celui de Vaux-Praslin, ancienne et fastueuse demeure du surintendant Fouquet. Cette magnifique propriété un instant délaissée a été restaurée dans ces derniers temps par le propriétaire actuel, M. Sommier, grand raffineur parisien. Les naïades y ont fait leur réapparition, mais on n’entend plus la muse plaintive du bon La Fontaine pleurant sur le sort du malheureux Oronte.
La petite commune de La Rochette évoque le souvenir d’une vieille et illustre famille agricole de la Brie. « Un nom, dit l’abbé Denis, qui a droit d’être signalé à tous égards, est celui de Moreau de La Rochette, inspecteur général des pépinières de France. Il était directeur des fermes du roi à Melun quand il fit l’acquisition, en 1751, de la terre de La Rochette, ainsi nommée à cause de son sol ingrat, rocailleux. Il s’attacha d’abord à mettre en bon état le peu de terre qui était cultivée, puis, grâce à son intelligence et à la constance de sa volonté, il étendit sa culture en dirigeant habilement les labours, et, en distribuant à piopos les engrais, il obtint ainsi de bonnes récoltes. Les succès se multipliant, il conçut le projet d’une école d’agriculture sur sa propriété. Il tourna ses vues principalement du côté des pépinières et employa à ce dessein des enfants trouvés des hôpitaux de Paris. Le terrain fut défoncé, une partie fut mise en culture et l’autre en bois. En treize années, quatre cents élèves sortis des hôpitaux avaient été formés au travail de la terre et étaient devenus jardiniers pépiniéristes, et lorsqu’en 1780 la terre de La Rochette, par suite des réformes de Necker, cessa d’être au compte du gouvernement il y existait 7,431,000 plants d’arbres de toute espèce. Moreau mourut à La Rochette en 1791. »
Les descendants de cette illustre famille s’occupèrent d’agriculture, d’élevage, de sport, et le dernier rejeton, récemment décédé, fut longtemps président de la Société d’agriculture de Melun.

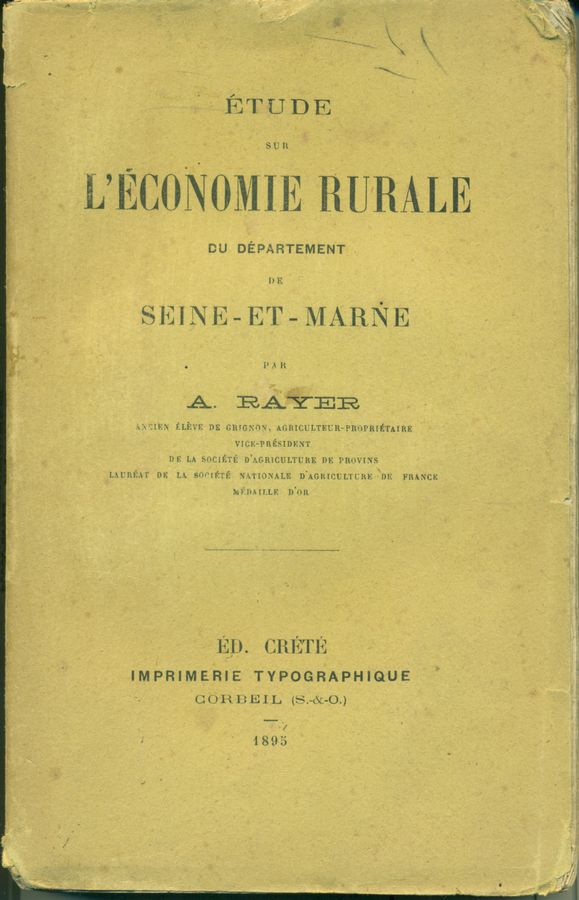
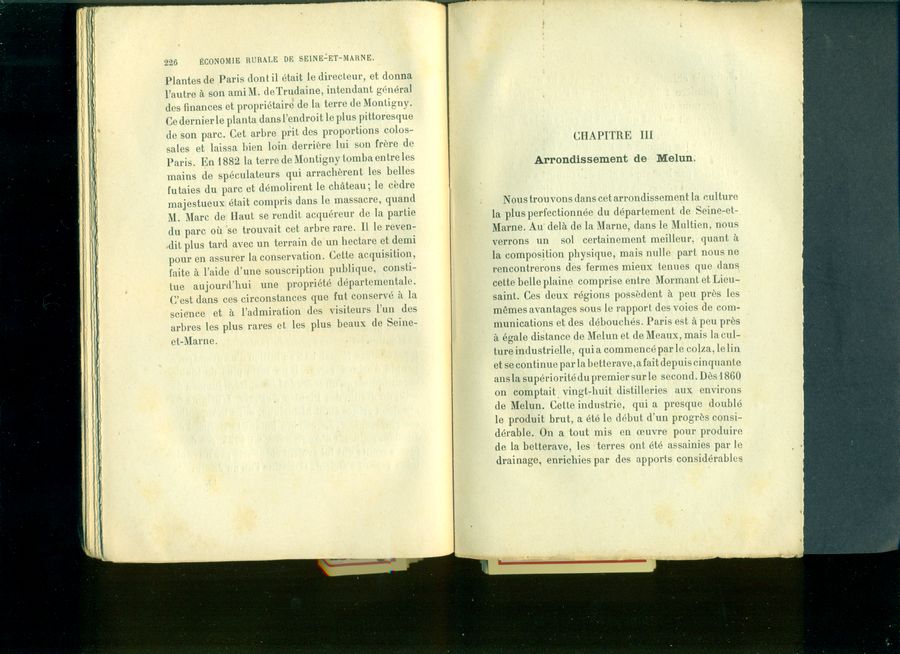
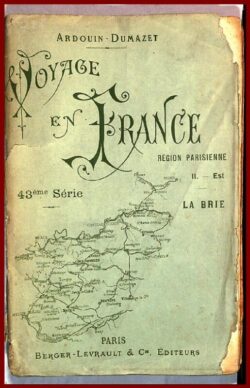
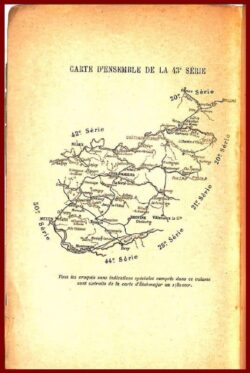
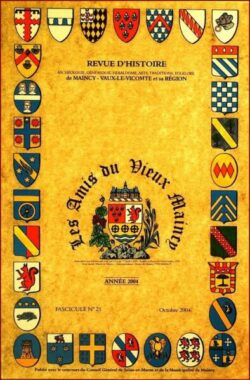
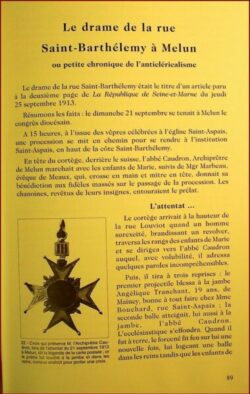
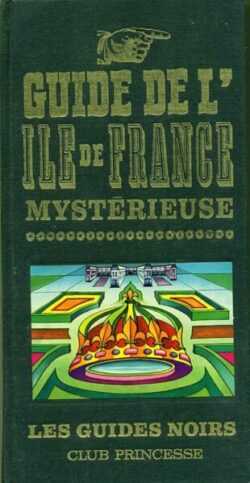
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.